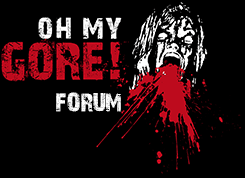Sans véritables notions cinématographiques dans sa poche, David Cronenberg va successivement réaliser quelques années avant ses premiers films reconnus deux moyens-métrages aussi étranges et expérimentaux qu'intéressants, dans lesquels il remet en question les bases de la science, la psychologie et la médecine de son époque et dessine déjà une esquisse de ses futures obsessions.
Stereo (1969)

Avant l'émancipation de son style avec Frissons et Rage, Cronenberg réalisait ce moyen-métrage très particulier, où le son et les dialogues se voient remplacés par des voix-off traitant d'une espèce d'énorme baratin scientifique concentré sur la télépathie humaine. Il faut ainsi y discerner un humour omniprésent, qui s'ingénie, non sans subtilité, à malmener les théories scientifiques bancales quant à la facette cérébrale de l'homme. Dans un noir/blanc somptueux et des décors d'immeubles ultramodernes sans fin, le cinéaste semble d'ores et déjà manifester un goût ostensible pour les ambiances feutrées et cliniques, même s'il ne développe encore le caractère horrifique et grand-guignolesque de ses uvres futures. Il filme une poignée de cobayes humains dont les attitudes nous sont décrites par les commentaires des narrateurs et l'on retiendra la saisissante composition de Ronald Mlodzik - qui héritera par ailleurs de rôles plus anecdotiques dans Frissons et Rage - dont le physique et l'expressions si étranges suffisent à marquer l'esprit. Toutefois, malgré l'intérêt dont il fait montre, Stereo peut ennuyer par son absence catégorique d'intrigue, se limitant à une succession de saynètes explicatives, ce qui a pour cause de le rendre purement expérimental et difficilement accessible.
6/10

Crimes of the Future (1970)

Réalisé un an après Stereo, Crimes of the Future fut élaboré dans les mêmes conditions que son prédécesseur: même équipe, même budget, lieu de tournage similaire et concept d'ambiance et de mise en scène à peu près équivalent (son coupé au profit d'une voix-off explicative et de sons psychédéliques). Le noir/blanc et le charabia scientifique volontairement grotesque laissent néanmoins place à la couleur et une savoureuse satire sur la pathologie. Une fois encore, Ronald Mlodzik excelle dans le rôle principal, interprétant le personnage excentrique de directeur d'une ancienne clinique dermatologique devenue un centre de soin pour les victimes d'une curieuse épidémie. Cronenberg démontre sa fascination pour les lieux architecturaux modernes (couloirs et façades externes d'immeubles) mais décide cette fois-ci de rendre les commentaires du narrateur clairement saugrenus, tout comme les situations et les agissements des personnages. Il en résulte une sorte de comédie malsaine qui ne sera certes pas du goût de tout le monde - action inexistante, prolongation de temps morts, art de la contemplation - mais, de la même manière que Stereo, au demeurant assurément intéressante par l'atmosphère clinique, feutrée et oppressante qu'elle distille. David Cronenberg était à ce moment-là ce que l'on peut appeler un génie en devenir.
7/10