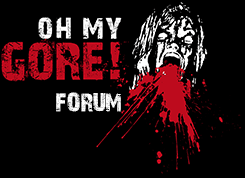Titre d'origine: Picnic à Hanging-Rock
Réalisateur: Peter Weir.
Année: 1975.
Origine: Australie.
Durée: 1h45.
Distribution: Rachel Roberts, Dominic Guard, Vivean Gray, Helen Morse, Kirsty Child, Tony Llewellyn-Jones, Jacki Weaver, Anne-Louise Lambert.
Récompenses: Grand Prix au Festival des Nations à Taormina
Prix d'Interprétation Féminine décernée à l'ensemble des comédiennes au Festival du Rex de Paris.
FILMOGRAPHIE: Peter Weir est un réalisateur australien, né le 21 Août 1944, à Sydney, Australie.
1974: Les Voitures qui ont mangé Paris. 1975: Pique-nique à Hanging Rock. 1977: La Dernière Vague. 1981: Gallipoli. 1982: l'Année de tous les Dangers. 1985: Witness. 1986: Mosquito Coast. 1989: Le Cercle des Poètes Disparus. 1990: Green Card. 1993: Etat Second. 1998: The Truman Show. 2003: Master and Commander. 2011: Les Chemins de la Liberté.
Ce que l'on voit et ce que l'on perçoit n'est qu'un rêve... Un rêve dans un rêve.
Grand succès public dans son pays d'origine, Pique-nique à Hanging Rock doit la singularité de son scénario grâce au roman de Joan Lindsay, publié en 1967. Auréolé d'un Grand Prix au Festival des Nations à Taormina (Sicile), ce chef-d'oeuvre clairsemé, seconde réalisation d'un auteur écolo, doit son pouvoir hypnotique par la grâce d'une aura fantasmatique difficilement définissable.
Le 14 Février 1900, des jeunes filles du collège Appleyard pique-niquèrent à Hanging-Rock dans le Victoria. Au cours de l'après-midi, plusieurs membres du groupe disparurent sans laisser de traces.
A partir de cet argument soupçonneux, Peter Weir nous brode une intrigue fantastique imprégnée d'étrangeté, voir de mysticisme écologique. C'est un florilège d'images poétiques qu'il nous façonne de façon épurée pour illuminer durant la sérénité d'un pique-nique la nature solaire et ses jeunes filles en dentelle de robe blanche, égarées au beau milieu d'immenses rochers. Son préambule dédié à la beauté lascive de ces collégiennes enivrées par la flore environnante, est transcendé par le score monocorde composé à la flûte de pan par Bruce Smeaton. Cette succession de séquences charnelles sont d'autant plus fascinantes par leur aura ensorcelante que la destinée pressentie des disparues va nous laisser, comme chacun des protagonistes, dans l'interrogation d'une énigme irrésolue !
Après l'annonce de ces disparitions (ou enlèvements) inexpliqués, la tragédie va notamment lourdement influer sur le comportement anxiogène des camarades de classe, tributaires d'une enseignante hautaine et d'un climat scolaire contrariant. Une mégère orgueilleuse incapable de faire preuve de charité face à la bonhomie de jeunes filles accablées par la perplexité. De manière dégénérative, cette confrérie généralement féminine (en dépits de quelques occupants dont un amant planqué sous les draps d'une majordome) va être sujette à une succession d'évènements dramatiques fortuits. Comme si une malédiction s'était abattue sur la bannière du pensionnat de prime abord tranquille et réputé. Et cela, en dépit de la découverte miraculeuse de l'une d'entres elles, finalement retrouvée sous la montagne rocheuse par un jeune enseignant préalablement amoureux.
Avec son ambiance feutrée d'étrangeté sous jacente et le climat obscur d'un institut académique en proie à une triste fatalité, Peter Weir joue habilement avec la caractérisation psychologique de ces personnages confrontés à une tragédie saugrenue. Puisque ce drame lacunaire en quête de vérité va finalement plonger cette hiérarchie autoritaire dans le désarroi. ATTENTION SPOILER !!! Démission d'un membre du personnel, départ précipité d'une survivante et renvoi d'une collégienne suicidaire vont un peu plus plonger dans l'aigreur destructrice une directrice confinée vers l'alcoolisme, car convaincue de sa vanité et sa part de responsabilité. FIN DU SPOILER. De cette déchéance morale émane une ambiance ombrageuse laminée par l'amertume. Notamment la détresse fragilisée d'adolescentes confrontées à la perte de leurs camarades et de l'arrogance de leur matriarche. Dans une atmosphère susceptible de préoccupation, le réalisateur véhicule un sentiment de malaise vaporeux et surtout un pouvoir d'envoûtement insufflé au spectateur transi de trouble.
Songe d'une nuit d'été.
D'un esthétisme raffiné pour idéaliser sa nature champêtre et la candeur de demoiselles prêtes à s'éclipser vers une horizon inconnue, le chef-d'oeuvre de Peter Weir tend à harmoniser la campagne australienne, éperdue d'amour pour cette virginité féminine (et inversement !). Son aura d'étrangeté imperceptible et sa poésie élégiaque compromises à une tendre cohésion entre la femme et la flore laissent le spectateur en état d'apesanteur. Comme si le temps s'était subitement obstrué pour mieux nous immerger dans la volupté d'une idylle spirituelle mais aussi d'un cauchemar lattent. Ce cinéma venu d'Australie élève l'art de la suggestion avec une acuité de fascination inhabituelle, quintessence d'un fantastique audacieux dans sa conviction utopique.
Pique-nique à Hanging-Rock
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Cinéma Horreur & Fantastique
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités